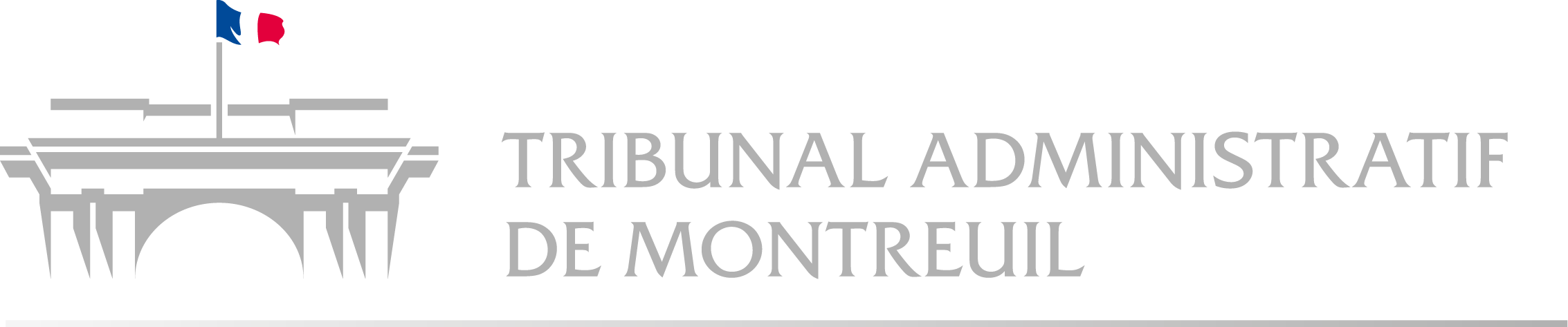Panorama de la jurisprudence de la juridiction
Antoine Marmier, rapporteur public près la 1ère chambre
Dans l’ouvrage de la collection Que sais-je qu’il a consacré au droit administratif, le professeur Prosper Weil considère que « l’existence même d’un droit administratif relève en quelque sorte du miracle ». Il poursuit en affirmant que « Né d’un miracle, le droit administratif ne subsiste au surplus que par un prodige chaque jour renouvelé ». Ce miracle se fonde sur l’équilibre subtil visant à « concilier les droits de l’État avec les droits privés ». Il se nourrit de faits et de circonstances plus ou moins ordinaires : l’accident d’Agnès Blanco renversée par un wagonnet de la manufacture des tabacs de Bordeaux, la conférence de René Benjamin à Nevers, la candidature d’étudiants communistes au concours de l’école nationale d’administration ou la créativité d’une société la conduisant à faire du lancer de nain une activité commerciale.
Depuis maintenant cinq ans, la juridiction située au 7 de la rue Catherine Puig à Montreuil participe, à travers les situations parfois pittoresques dont elle est saisie, à la perpétuation du prodige. Le tribunal a eu, au cours de l’année judiciaire écoulée, à trancher nombre de questions qui traduisent le rôle croissant et diversifié de ses interventions. Une soixantaine de décisions, pour la plupart dans le contentieux fiscal, ont été répertoriées comme présentant un intérêt juridique réel. Leur consultation sera d’ailleurs prochainement accessible sur le site internet de la juridiction.
Notre présentation de la jurisprudence du tribunal, qui ne peut prétendre à l’exhaustivité, s’articulera autour de trois domaines distincts : le contentieux social, celui de la vie locale et celui du droit fiscal.
1. Le Tribunal administratif de Montreuil a si, l’on peut dire, une vocation sociale assez prononcée, liée à la spécificité du département unique relevant de son ressort.
1.1 Le contentieux des refus de titres de séjour sollicités par des personnes étrangères constitue une part importante de son activité. Il est parfois confronté à des questions juridiques inédites, notamment lorsqu’une réforme législative intervient, ce qui n’a pas été le cas depuis l’été 2011. Mais le plus souvent il lui appartient de contrôler l’application, par l’administration, de règles juridiques connues à des situations particulières.
C’est ainsi que la 9ème chambre, spécialisée dans ce contentieux, a eu à juger de la légalité d’un arrêté préfectoral refusant un titre de séjour à un ressortissant cap-verdien au motif qu’il constituait une menace à l’ordre public (20 mars 2014, M. X., 1310173). Faisant application des principes dégagés par le Conseil d’État selon lequel seul un motif d’ordre public suffisamment grave peut justifier un refus de titre de séjour sollicité au titre de la vie privée et familiale, la formation de jugement a estimé que si l’intéressé résidait en France de manière habituelle depuis 1979 et y disposait de nombreux liens, il s’était rendu coupable d’un meurtre pour lequel il avait été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement par la Cour d’assises du Calvados. Ce motif d’atteinte à l’ordre public était en l’espèce suffisamment grave pour que la décision du préfet ne soit pas regardée comme portant atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
Autre illustration du contrôle des faits par le juge, la même chambre a annulé une décision refusant une autorisation de travail à un ressortissant algérien bénéficiant d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant (13 février 2014, M. Y., 1311463). Elle a estimé que pour apprécier l’adéquation entre, d’une part, la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et, d’autre part, les caractéristiques de l’emploi exigée par l’article R. 5221-20 du code du travail, le préfet n’avait pu se fonder sur le fait que l’intéressé ne travaillait précédemment qu’à 60 %, alors qu’il exerçait une activité d’assistant manager depuis près de deux ans et qu’il avait pu, pendant cette période, acquérir l’expérience requise. Elle a également censuré le second motif opposé par le préfet tenant au fait que le métier était ouvert à des personnes à partir d’un diplôme de niveau CAP/BEP à bac +2 en hôtellerie restauration, alors que le demandeur était titulaire d’une maîtrise en lettres et en langues, le fait que l’étudiant dispose d’un diplôme supérieur à celui requis ne pouvant être retenu pour refuser l’autorisation.
1.2 La vocation sociale du tribunal a également été illustrée dans le cadre d’une affaire de police administrative, démontrant qu’ordre disons social et ordre public ne sont pas inconciliables.
La gestion d’une résidence hôtelière dénommée « Les séjours du Grand stade », située rue Jesse Owens sur le territoire de la commune de Saint-Denis, avait été confiée par convention à une société, laquelle était également liée contractuellement au Samu social de Paris qui dirigeait vers elle des personnes en situation de détresse. La société gestionnaire ayant résilié les deux conventions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de prendre un arrêté de réquisition de la résidence pour une durée d’un an qu’il a prorogé, par un nouvel arrêté du 15 mars 2013, pour la même durée. C’est ce second arrêté dont la commune de Saint-Denis a demandé l’annulation.
La 6ème chambre du tribunal a jugé le 5 juin 2014, (Commune de Saint-Denis, 1305002) que l’arrêté de réquisition pouvait être fondé sur les pouvoirs que détient le préfet en vertu du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales qui l’autorise, lorsque l’urgence et l’ordre public le justifient et que les pouvoirs de police ne permettent plus de poursuivre leurs objectifs, à se substituer au pouvoir de police du maire et procéder à une réquisition de biens.
La formation de jugement a relevé que le préfet ne disposait pas d’autre solution, dès lors qu’il existait un contentieux relatif à des règlements de loyers impayés entre le Samu social de Paris et la société titulaire des baux commerciaux de la résidence, faisant obstacle à ce que les deux organismes nouent une relation contractuelle de substitution.
Elle a également estimé que la situation d’urgence résultait du fait que la convention résiliée avec le Samu social portait sur douze autres résidences représentant 1 500 personnes hébergées dans le département et que les services préfectoraux n’avaient pas ménagé leurs efforts puisqu’ils avaient procédé, au cours des 11 mois précédant l’arrêté contesté, au relogement de 800 personnes. Et pour la seule résidence « Les séjours du Grand stade », plus d’une centaine de personnes sur les 395 occupants avaient été relogés à la date de l’arrêté. L’absence de mise en œuvre du pouvoir de réquisition aurait conduit à créer un trouble à l’ordre public qui ne pouvait être réglé par la seule mise en œuvre du pouvoir de police dès lors qu’elle aurait conduit à priver d’accès à un logement 271 personnes dont 155 enfants et ce en période hivernale.
1.3 Enfin, dans le volet droit du travail qui lui incombe, la 5ème chambre du tribunal a été confrontée à un nouveau contentieux pour lequel elle a été la première à préciser ou faire préciser certaines règles. Il s’agit du contentieux des plans de sauvegarde de l’emploi devant être établis dans les entreprises d’au moins 50 salariés lorsque le projet de licenciement économique concerne au moins 10 salariés sur une période de 30 jours.
Dans ce nouveau cadre juridique, le tribunal a sollicité une explicitation des règles de compétence territoriale. Il a transmis une affaire au Conseil d’État, qui par une décision du 24 janvier 2014, Comité d’entreprise de la société Ricoh France (374163), a estimé que cette compétence dépendait du siège du ou des établissements concernés par la procédure. Le tribunal a également défini les conditions d’application de la loi dans le temps qui sont déterminées par la date à laquelle a été envoyée la première convocation au comité d’entreprise (7 février 2014, Comité d’entreprise Safig et autres, 1311216).
Surtout, cette formation de jugement a été conduite à apporter des précisions sur les modalités de la concertation qui doit intervenir entre l’employeur et les représentants du personnel pour aboutir au plan de sauvegarde. Elle a fixé comme règle générale que les omissions ou les irrégularités qui peuvent affecter la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel ne sont de nature à entraîner l’annulation de la décision de validation du plan de l’accord collectif majoritaire sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi que dès lors qu’elles ont eu pour objet ou pour effet de priver ces instances de la possibilité de débattre, de faire des propositions et des suggestions et de rendre un avis sur le projet qui leur est soumis en toute connaissance de cause.
Dans ce cadre, qui évoque la jurisprudence Danthony du Conseil d’État (23 décembre 2011, 335033) tendant à éviter les annulations pour des vices de forme qui n’ont pas d’influence sur le sens de la décision ou qui ne privent pas l’administré d’une garantie, la 5ème chambre a jugé que la circonstance que le caractère insuffisant des éléments transmis par l’employeur lors de la première réunion du comité d’entreprise concernant le nombre de postes offerts au reclassement était sans incidence sur la régularité de la consultation dès lors que l’information a été précisée au cours des autres réunions de négociation du plan (7 février 2014, Syndicat CGT DARTY IDF,1311393).
2. Le tribunal enrichit également la jurisprudence administrative à travers le contentieux dont il est saisi concernant des décisions prises par les collectivités territoriales.
2.1 En matière de fonction publique, la 4ème chambre a précisé auprès de quelle autorité administrative un fonctionnaire territorial placé en situation de mise à disposition devait s’adresser pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il avait droit au titre des fonctions exercées dans son administration d’origine (19 juin 2014, M. H., 1310616).
Rappelant qu’une partie de la rémunération d’un fonctionnaire mis à disposition, notamment la NBI, lui est servie par l’administration d’origine, le tribunal a jugé qu’il ne pouvait pas demander le versement de cette part à l’administration auprès de laquelle il était mis à disposition.
La 4ème chambre a en outre statué sur une affaire dont les faits sont caractéristiques du contentieux de la fonction publique.
Un adjoint administratif d’une commune a demandé sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, ce que la collectivité a accepté. Mais l’agent, ayant changé d’avis, a contesté cette mesure devant le tribunal administratif qui a annulé l’arrêté de mise à la retraite. Ce jugement sera annulé par la suite par la Cour administrative d’appel de Versailles ce qui conduira le maire à reprendre un arrêté de mise à la retraite à compter de la date initialement prévue. D’un point de vue financier, le maire a émis un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de la rémunération qu’il estimait avoir été versée à tort au titre de la période s’étant écoulée entre le jugement et l’arrêt.
S’inspirant des principes dégagés par le Conseil d’État dans un cadre différent (CE, 13 juin 2012, Ministre du budget c/ M. S., 333798), le tribunal a, de nouveau saisi, jugé le 6 février 2014 (Mme T., 1307945) que la période au titre de laquelle l’agent avait été maintenu en activité devait être rémunérée, en application de la règle du service fait. Cette rémunération ne devait pas en revanche être prise en compte au titre des droits à pension et par conséquent le traitement ne devait pas être amputé de retenues pour pension.
2.2 En matière d’urbanisme, le tribunal a eu à s’interroger sur les conditions d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 juillet 2013, celle-ci ayant pour objet de sécuriser les règles de ce contentieux singulier. A ce titre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge, constatant qu’un permis de construire est seulement entaché d’un vice susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, de surseoir à statuer jusqu’à ce que ce permis modifié soit produit devant lui.
Saisi d’un recours contre l’arrêté du maire de Montreuil accordant à sa commune un permis de construire un groupe scolaire, la 2ème chambre du tribunal a, par un premier jugement (28 novembre 2013, Association Assquavie, 1210691), considéré que le permis était entaché d’une seule irrégularité tenant au fait que le maire ne disposait pas, en application des dispositions combinées de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’une autorisation du conseil municipal pour demander ce permis de construire.
L’association à l’origine du recours, considérait que les dispositions issues de l’ordonnance du 18 juillet 2013, entrées en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel le 19 juillet, ne pouvaient pas s’appliquer à ce litige puisque le permis contesté avait été délivré antérieurement, le 31 octobre 2012.
Toutefois, s’agissant d’une loi qui régit « l’activité des juges » et non le droit au recours des parties, le tribunal a décidé de l’appliquer au présent litige. Il a donc sursis à statuer laissant à la commune de Montreuil un délai de six mois pour lui notifier le permis de construire modificatif. C’est ce qu’elle a fait et, le vice initial ayant été corrigé, le tribunal a finalement rejeté la requête de l’association (5 juin 2014, Association Assquavie, 1210691).
Le Conseil d’État a confirmé la lecture du tribunal sur l’application dans le temps des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (Avis CE, 18 juin 2014, Société Batimalo et commune de Saint-Malo, 376760).
2.3 La clause de compétence générale offre aux communes, qui semblent à ce jour à l’abri de sa suppression, une assez grande liberté que le juge administratif est régulièrement appelé à encadrer.
Ainsi, la 3ème chambre a eu à connaître de la délibération du conseil municipal d’une commune qui avait décidé de déclarer citoyen d’honneur de la ville un ressortissant de nationalité libanaise, pourtant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d’assises de Paris, pour complicité d’assassinats et tentative d’assassinat, dans le cadre d’actions terroristes. Cette délibération, qui avait pour objet d’inciter les autorités compétentes à procéder à la libération de l’intéressé, faisait référence à la guerre survenue en 1978 entre le Liban et Israël, à la cause palestinienne et à l’opposition des États-Unis à la libération du condamné.
Le tribunal a jugé le 4 juillet 2014 (Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme et autres, 1400324) que, d’une part, et cela est une première, cette délibération avait le caractère d’un hommage public et qu’elle pouvait, dès lors, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. D’autre part, il l’a annulée car elle n’était pas justifiée par un intérêt local, comme le prévoit l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, et elle portait atteinte à l’ordre public.
La 5ème chambre a été saisie d’une affaire qui illustre également la portée réelle de la clause générale de compétence. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a en effet déféré la délibération d’un conseil municipal aux termes de laquelle le maire et les adjoints étaient autorisés à faire acte d’objection de conscience et, ainsi, à ne pas procéder à la célébration des mariages ouverts aux couples de personnes de même sexe par la loi du 17 mai 2013. Le tribunal a annulé cette décision aux motifs qu’elle ne présentait pas d’intérêt local, le maire et les adjoints agissant dans ce domaine en qualité d’officiers d’état civil, et qu’elle avait pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une loi (24 décembre 2013, Préfet de la Seine-Saint-Denis, 1310609).
2.4 Il n’est pas possible d’achever cette chronique de la vie locale sans évoquer l’une des affaires examinée par le juge des référés en matière électorale.
Un candidat tête de liste aux élections municipales a saisi le juge du référé-liberté car le maire refusait de lui remettre les attestations d’inscription sur la liste électorale de ladite commune des candidats de la liste qu’il comptait mener. Le maire considérait que cette démarche devait être effectuée personnellement par chacun des candidats.
Par une ordonnance du 6 mars 2014 (M. B., 1401854), le juge des référés a estimé que la condition d’urgence était satisfaite dès lors que la clôture de dépôt des listes était fixée au même jour à 18h. Il a également jugé, et c’est là que réside plus particulièrement l’intérêt de cette décision, que la tête de liste, qui disposait d’un mandat de ses colistiers pour effectuer toute déclaration ou démarche utile à l’enregistrement de la liste en vertu de l’article L. 265 du code électoral, pouvait sur ce fondement solliciter les attestations d’inscription sur la liste électorale de ses colistiers.
L’efficacité du référé-liberté s’est une nouvelle fois manifestée. L’injonction faite au maire de la commune, agissant dans ce domaine au nom de l’État, de délivrer les attestations a permis à la tête de liste de déposer celle-ci dans le délai imparti.
3. Nous conclurons ce panorama en évoquant la jurisprudence des trois chambres fiscales du tribunal qui constituent la seconde spécificité de la juridiction.
3.1 La 10ème chambre a tranché quelques questions inédites comme celle de savoir si des produits financiers perçus par la banque centrale de Singapour et issus de titres dénommés ADR détenus par une banque américaine pouvaient être exonérés de retenues à la source sur le fondement de l’article 131 sexies du code général des impôts. Elle a répondu négativement car la condition relative à ce que les titres soient déposés auprès d’un établissement de crédit établi en France n’était pas remplie alors même que les produits financiers perçus résultaient d’actions de sociétés françaises (15 novembre 2013, Monetary Authority of Singapore, 1209983).
L’actualité de cette chambre est essentiellement marquée par les requêtes présentées par des fonds communs de placement et des organismes à but non lucratif, près de 2 700 au total, qui demandent la restitution de retenues à la source au motif qu’elles ont été appliquées en méconnaissance de la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 56 du Traité instituant la Communauté européenne.
La question de la recevabilité de ces requêtes a posé de réelles difficultés tant juridiques que pratiques pour les requérants. En effet, l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales précise que toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une pièce justifiant le montant de la retenue à la source ou du versement. Le Conseil d’État a précisé que cette preuve pouvait être apportée par toutes pièces précisant la date et l’établissement payeur (Avis n° 344678 à 344687 du 23 mai 2011 Société Santander Asset Management SGIIC SA et autres).
La principale difficulté alléguée par les requérants portait sur leur absence de lien avec l’établissement payeur chargé de verser les retenues au Trésor public français, les fonds affirmant que la preuve à apporter était impossible. Néanmoins, au cours de cette année, ils ont produit les pièces répondant aux exigences fixées par le Conseil d’État et leur permettant d’obtenir satisfaction.
Il convient de préciser que les enjeux financiers posés par ces contentieux sont considérables, pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros par dossier et qu'en ce qui concerne la série dite des OPCVM le gouvernement a dû provisionner au budget quelques milliards d'euros, ce qui n'est pas sans conséquences dans un contexte de déficit budgétaire important.
3.2 De son côté, la 11ème chambre, a connu, en matière de fiscalité locale, d’une affaire concernant un club de football dont la devise n’est pas « Droit au but » mais « Rêvons plus grand ».
La question était de déterminer si les produits liés à la cession des contrats de joueurs, intervenant dans le cadre de ce qui est appelé le « mercato », c’est-à-dire les deux périodes annuelles de transfert de joueurs entre les clubs, devaient être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, servant d’assiette à la cotisation minimale de taxe professionnelle.
La société gérant le club avait considéré qu’il s’agissait de produits exceptionnels n’entrant pas dans le champ d’application de la valeur ajoutée au sens de l’article 1647 B sexies du code général des impôts.
Le tribunal (2 décembre 2013, SA Paris Saint Germain Football, 1207203-1301926) n’a pas retenu cette analyse dès lors que ces produits présentaient, d’une part un caractère récurrent (sur la période en litige étaient intervenues pour chaque saison, entre une et cinq cessions) et, d’autre part, un caractère substantiel (les produits étant proches de 13 millions d’euros au titre de deux exercices).
Dans le même cadre juridique, la 11ème chambre a jugé, dans une affaire relative à la SNC Louis Vuitton, que les dépenses de mécénat exposées par une entreprise n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée (19 juin 2014, 1308456) car elles correspondent à une libéralité de sa part, ne sont pas liées à son activité ordinaire et ne sont pas à mentionner dans un des comptes de charges énumérés par l’article 1647 B sexies du CGI.
3.3 C’est sur une note d’espérance que cet exposé pourra s’achever, même s’il n’est pas certain que l’administration fiscale la partage au regard du montant en litige qui s’élève à 366 millions d’euros.
Par un jugement récent du 6 octobre (1305900 et 1307719), la 1ère chambre a statué sur la requête de la société Vivendi qui demandait à bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé au titre de l’exercice 2011, régime permettant de s’extraire des règles afférentes à la territorialité de l’impôt sur les sociétés. La société bénéficiait d’un agrément à cet effet accordé en 2004 et renouvelé le 13 mars 2009 pour une période de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2011. Toutefois avant la clôture de l’exercice 2011, le Parlement a adopté une loi de finances rectificative le 19 septembre 2011 qui a mis fin à ce régime fiscal à compter du 6 septembre 2011. Elle avait ainsi un caractère rétroactif pour la société requérante.
Se plaçant dans le sillon tracé par le Conseil d’État dans un arrêt de plénière du 9 mai 2012 (Ministre du budget c/ Société Epi, 308996), le tribunal a jugé que du fait de l’agrément dont elle bénéficiait et qui ne lui avait pas été retiré à la date de la loi de finances rectificative, la société Vivendi possédait une espérance légitime de bénéficier d’une créance au sens des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme. L’agrément créait des droits à cette société et la loi fiscale prévoyait, à travers l’agrément, l‘application d’un régime fiscal pour une durée limitée, contrairement à la plupart des autres lois fiscales dont le contribuable averti sait que tant que le fait générateur de l’impôt n’est pas intervenu, il peut s’attendre à ce que, les règles de son imposition soient modifiées.
L’espérance légitime d’une créance étant constatée, le tribunal a estimé qu’il n’existait aucun motif d’intérêt général justifiant qu’il y soit porté atteinte dès lors que le seul motif invoqué par l’administration et les parlementaires était d’ordre budgétaire, la suppression du régime du bénéfice mondial consolidé ayant seulement pour objet d’abonder immédiatement les caisses de l’Etat d’un montant évalué entre 150 et 200 millions d’euros.
Telles sont les affaires du tribunal qui nous ont paru mériter une attention particulière et qui, nous l’espérons, ont permis de lever certains mystères du droit administratif.